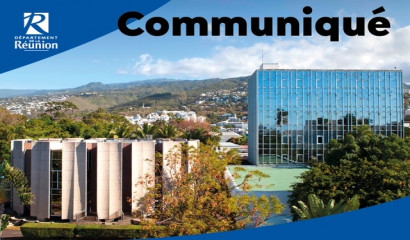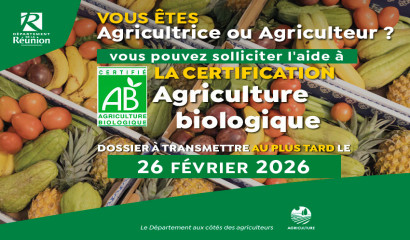Clôture du diagnostic alimentaire départemental de La Réunion
Projet Alimentaire Territorial du Département de La Réunion Date : 2 octobre 2025 Participants : ~50 acteurs (collectivités, services de l’État, interprofessions, recherche, associations, etc.)
Document à télécharger :
Webinaire restitution du 02/10/2025.pdf
Contexte de l’étude :
En 2024, le Département de La Réunion a engagé la réalisation d’un diagnostic alimentaire, première étape structurante de son Projet Alimentaire Territorial (PAT) « Sa ki fé ansanm pou manz péi ».
Ce diagnostic avait pour objectifs de :
-
dresser un état des lieux clair et accessible de la situation alimentaire actuelle,
-
analyser les facteurs explicatifs et les impacts sur la population et l’environnement,
-
identifier les leviers d’action concrets pour améliorer durablement l’alimentation sur le territoire,
-
présenter la stratégie départementale et son plan d’actions priorisé.
Le travail a été conduit avec l’appui d’un bureau d’études, en associant de nombreux acteurs du territoire : collectivités, PAT communaux, chambres consulaires, services de l’État, monde agricole, acteurs de la transformation et de la distribution, associations et chercheurs.
Pour clore l’étude, un webinaire de restitution s’est tenu le 2 octobre 2025, réunissant environ 50 participants, issus d’une grande diversité de structures : services de l’État, collectivités locales, interprofessions, chambres consulaires, organismes de recherche, acteurs économiques et associatifs. Étaient par exemple représentés la DAAF, des communes porteuses de PAT et l’intercommunalité Territoire de l’Ouest, l’institut technique ARMEFLHOR, des organisations professionnelles comme ARIFEL ou ARIBEV, le Groupement des Agriculteurs Biologiques, des centres de recherche tels que le CIRAD et l’IRD, le pôle de compétitivité Qualitropic, des associations comme la Banque Alimentaire des Mascareignes, ainsi que le Département (agriculture, transition écologique et solidaire, action sociale) et l’ARS.
Enseignements du webinaire :
Constats clés présentés (issus du diagnostic) :
-
Dépendance aux importations : 77 % des volumes alimentaires à La Réunion sont importés (environ 448 000 tonnes en 2019), ce qui rend l’île vulnérable aux crises logistiques, économiques, sanitaires et géopolitiques.
-
Production locale :
-
Fruits frais : 60 % des besoins couverts (38 000 tonnes/an, avec l’ananas et la banane en tête).
-
Légumes frais : plus de 70 % des besoins (61 000 tonnes, tomate et chou dominants).
-
Viandes : 99 % des besoins en porc et 95 % en volaille (en frais).
-
Œufs : 100 % des besoins (134,7 millions produits en 2023).
-
Lait : 13 % seulement des besoins (17 millions de litres en 2023).
-
Produits de la mer : environ 5 000 tonnes/an.
-
Agriculture biologique : 2 397 hectares cultivés en bio en 2023.
-
Filière de transformation agroalimentaire : premier secteur manufacturier de l’île en 2023, avec 401 entreprises, 4 402 ETP et 1,36 Md € de chiffre d’affaires (dont 99 M€ à l’export). Dynamique mais freinée par la dépendance aux intrants importés et un manque d’infrastructures adaptées.
-
Qualité nutritionnelle / santé publique :
-
47 % de la population est en surcharge pondérale (2021).
-
Diabète de type 2 : 13,6 % des adultes (taux deux fois supérieur à la métropole).
-
Seuls 21 % des Réunionnais consomment les 5 portions quotidiennes de fruits et légumes.
-
Les aliments ultra-transformés représentent 19 % des quantités consommées et 35 % du budget alimentaire.
-
Inégalités sociales d’accès :
-
36 % des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté (contre 14 % en métropole).
-
1 habitant sur 10 dépend de l’aide alimentaire, avec une hausse de +6 à +20 % des demandes selon les structures.
-
Les produits alimentaires coûtent en moyenne 37 % plus cher qu’en France hexagonale.
-
Impacts environnementaux :
-
Empreinte carbone alimentaire : 2,5 tonnes éq. CO₂ par habitant et par an (+25 % par rapport à la métropole).
-
Utilisation d’intrants 3 à 4 fois plus élevée qu’en métropole (engrais, phytosanitaires).
-
Gaspillage alimentaire : 10,9 kg/an/habitant (dont 9,9 kg de produits non consommés).
-
Évolutions socioculturelles :
-
Le modèle du plat créole traditionnel (riz, cari, grains, rougail) reste central, mais concurrencé par les produits industriels (fast-food, pizzas, sandwiches).
-
Consommation de viande plus élevée qu’en métropole (surtout volaille et porc).
-
Produits laitiers nettement moins consommés.
-
Pratiques influencées par le budget, les normes sociales et la précarité (79 % des Réunionnais déclarent choisir leurs aliments d’abord en fonction du prix).
Atouts identifiés :
-
Diversité agricole et microclimats favorables.
-
Couverture quasi-totale des besoins en frais en œufs, porc et volaille.
-
Dynamisme de la filière agroalimentaire locale.
-
Mobilisation d’acteurs variés : PAT communaux, collectivités, associations d’aide alimentaire, chambres consulaires, services de l’État, monde agricole etc.
Pistes d’action prioritaires mises en avant par le diagnostic :
Trois axes stratégiques, déclinés en 12 actions :
Axe 1 : Changement des comportements alimentaires
-
Création d’une Haute Autorité Alimentation-Nutrition pour piloter et coordonner les actions.
-
Développement d’ateliers d’éducation populaire et de sensibilisation dans les collèges.
-
Stratégie de communication publique valorisant les produits sains, locaux et non ultra-transformés.
Axe 2 : Accès à une alimentation saine pour tous
-
Développement de marchés de producteurs dans les zones à faible accessibilité alimentaire.
-
Soutien à l’auto-production (jardins partagés, frigos solidaires, composteurs).
-
Renforcement et structuration du réseau d’aide alimentaire (épiceries solidaires, plateformes logistiques, stockage).
Axe 3 : Sécurisation des approvisionnements
-
Diversifier et structurer les filières locales à haute valeur nutritionnelle.
-
Développer des infrastructures de stockage et plateformes logistiques.
-
Créer une Charte de coopération régionale dans l’océan Indien.
-
Réduire la dépendance aux intrants importés (valorisation des biodéchets, économie circulaire).
Echanges avec les participants :
Les discussions qui ont suivi la présentation du diagnostic ont permis d’enrichir l’analyse et d’ouvrir des pistes complémentaires autour de plusieurs grandes thématiques :
-
Coopération régionale : les avis ont montré deux approches parfois divergentes. D’un côté, la nécessité de protéger et renforcer les filières locales pour assurer la souveraineté alimentaire ; de l’autre, l’intérêt de diversifier les sources d’approvisionnement, y compris avec les pays voisins, afin de réduire la dépendance aux importations hexagonales et européennes. Ces débats rappellent l’importance de trouver un équilibre entre sécurité alimentaire, souveraineté et ouverture, tout en veillant aux critères de qualité sanitaire, environnementale et sociale.
-
Communication et santé publique : au-delà de la valorisation des produits locaux sains, certains participants ont suggéré d’explorer des mesures plus volontaristes, voire réglementaires, à l’instar d’initiatives mises en œuvre au Mexique ou au Chili pour encadrer la communication et l’accès aux produits ultra-transformés, notamment auprès des jeunes. Ces propositions pourraient nourrir la réflexion collective dans le cadre de la future Haute Autorité de l’Alimentation et de la Nutrition (HAAN).
-
Cohérence et lisibilité des politiques publiques : plusieurs intervenants ont souligné la nécessité d’une meilleure articulation entre les différentes stratégies portées par le Département et ses partenaires (PAT, Agripéi 2030, plans liés à l’eau, santé publique, etc.). L’idée de réaliser une cartographie des plans et programmes existants à l’échelle de La Réunion a été proposée, afin de rendre visibles leurs complémentarités et de situer clairement le PAT dans le paysage global.
-
Investissements et infrastructures : la question du financement public de serres rigides anticycloniques a été évoquée, en lien avec la sécurisation des productions locales de fruits et légumes face aux aléas climatiques. Le renforcement des capacités de stockage et de transformation locale a également été identifié comme un levier essentiel pour améliorer la résilience alimentaire.
-
Qualité nutritionnelle et aide alimentaire : la nécessité d’améliorer la qualité des produits distribués dans les dispositifs de solidarité (paniers alimentaires, BQP, colis de la BAM) a été soulevée. Ce sujet sera approfondi dans le cadre des instances de gouvernance et de suivi du PAT.
Ces échanges riches et constructifs viendront nourrir la prochaine étape de co-construction du plan d’actions du PAT départemental, en veillant à conjuguer enjeux agricoles, alimentaires, sociaux et environnementaux.
Étapes suivantes :
La clôture du diagnostic ouvre la voie à la co-construction d’un plan d’actions opérationnel, qui servira de socle pour le passage en niveau 2 du PAT départemental. Cette démarche s’inscrit également dans la continuité et l’évaluation du plan AGRIPéi 2030, stratégie agricole départementale qui vise à bâtir une agriculture réunionnaise durable, nourrissante, diversifiée et résiliente à l’horizon 2030. En articulant le PAT, le diagnostic alimentaire et AGRIPéi 2030, le Département affirme sa volonté de relier les ambitions agricoles et alimentaires, afin de garantir à tous les Réunionnais une alimentation plus saine, plus locale et plus équitable.